Format papier
En septembre 2020, l’UNEQ a créé un nouveau périodique semestriel : Format papier, conçu par et pour ses membres.
Format papier s’inscrit dans le plan stratégique 2018-2022 de l’UNEQ, dont l’un des objectifs prioritaires, « Accroître le sentiment d’appartenance et de solidarité des membres de toutes les régions », nous imposait de voir grand et de ratisser large.
En février 2019, l’UNEQ a convoqué son Comité des régions à Québec pour un lac-à-l’épaule. Cette rencontre s’appuyait sur un sondage envoyé à tous les membres de l’UNEQ, qui a permis de connaître et de mieux comprendre vos attentes. L’UNEQ a tenu compte des résultats de ce sondage pour identifier, en fonction de son mandat, des pistes d’action.
Le conseil d’administration a ainsi dégagé des fonds pour permettre à un nouveau périodique de voir le jour. Il s’agit d’une revue thématique, consacrée aux enjeux qui concernent les membres de l’UNEQ, distribuée par la poste à tous les membres de l’Union.
Nous sommes fiers de renouer avec le bon vieux support papier pour vous offrir des articles de fond, ainsi que des œuvres d’écrivaines et d’écrivains québécois. L’instantanéité d’Internet est nécessaire pour diffuser un communiqué de presse ou pour communiquer rapidement avec vous sur un sujet d’actualité, mais pour mettre en valeur le travail littéraire des membres de l’UNEQ, avec des illustrations choisies et une mise en page aérée, nous avons misé sur l’imprimé, cet objet lent que l’on savoure en prenant son temps.
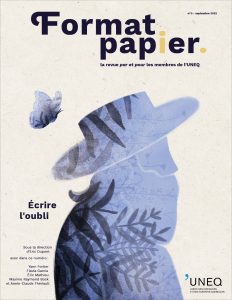 Numéro 5, septembre 2022 — Écrire l’oubli
Numéro 5, septembre 2022 — Écrire l’oubli
Sous la direction d’Eric Dupont
Sommaire
- Écrire l’oubli, par Eric Dupont
- Les croches, par Maxime Raymond Bock
- Variations sur le Grand Nord, la lumière et la mémoire, par Flavia Garcia
- Le lac Solar à Gore, par Yann Fortier
- Sortir du cadre, par Éric Mathieu
- La dissolution, par Annie-Claude Thériault

Numéro 4, mars 2022 — Écritures solidaires
Sous la direction de Louise Dupré
Sommaire
- Resserrer nos liens, par Louise Dupré
- Poésie en forêt, par Jean Désy
- Je suis là, par Lorrie Jean-Louis
- Place de trêve, par Audrée Wilhelmy
- À l’heure de l’inquiétude, par Louise Cotnoir
- De l’écriture queer, par Jean-Paul Daoust
- La place du cœur, par Laure Morali
Numéro 3, septembre 2021 — Portraits de la solitude
Sous la direction de Louise Dupré
Sommaire
- Un numéro préparé, par Louise Dupré
- Marcher à côté de soi, par Paul Chanel Malenfant
- En dérive, par Élisabeth Vonarburg
- La femme aux quatorze yeux, par Chloé Savoie-Bernard
- Périphérique, par Gabriel Robichaud
- Je boirai le calice jusqu’à la lie, par Claudia Larochelle
- Mes saisons, par Denise Desautels
Numéro 2, mai 2021 — Libertés
Sous la direction d’Erika Soucy
Sommaire
- Un numéro heureux, par Erika Soucy
- Liberté bien méritée, par André Marois
- La liberté, notre maladie, par Roxane Nadeau
- L’incroyable mésaventure de la pièce de Adel al-Mansour, par Salah El Khalfa Beddiari
- La Floune, par Gabriel Marcoux-Chabot
- L’heure du thé, par Perrine Leblanc
Numéro 1, septembre 2020 — L’argent est littéraire
Sous la direction d’Erika Soucy
Sommaire
- L’argent est littéraire, par Erika Soucy
- Encaisse, par Annie Landreville
- Combien, par Catherine Voyer-Léger
- à rebours, par Lula Carballo
- Crédit, par Annie Landreville
- Comme si de rien n’était, par Laetitia Beaumel
- Léo, écrivain, par Michel Rabagliati







